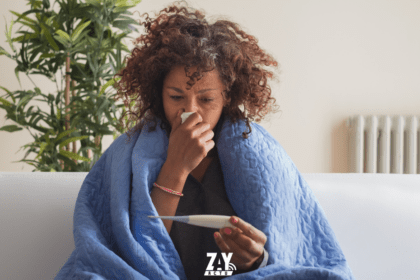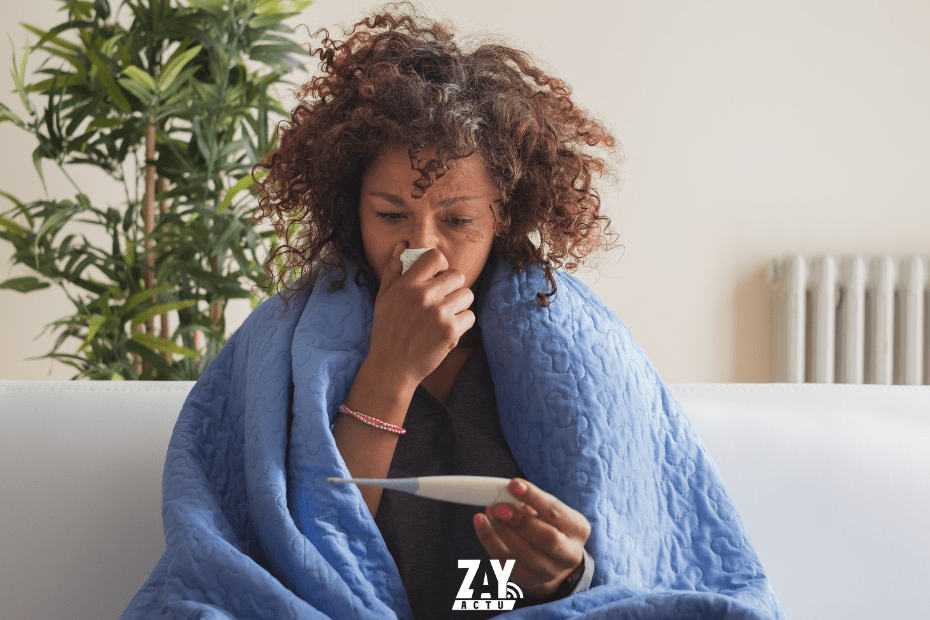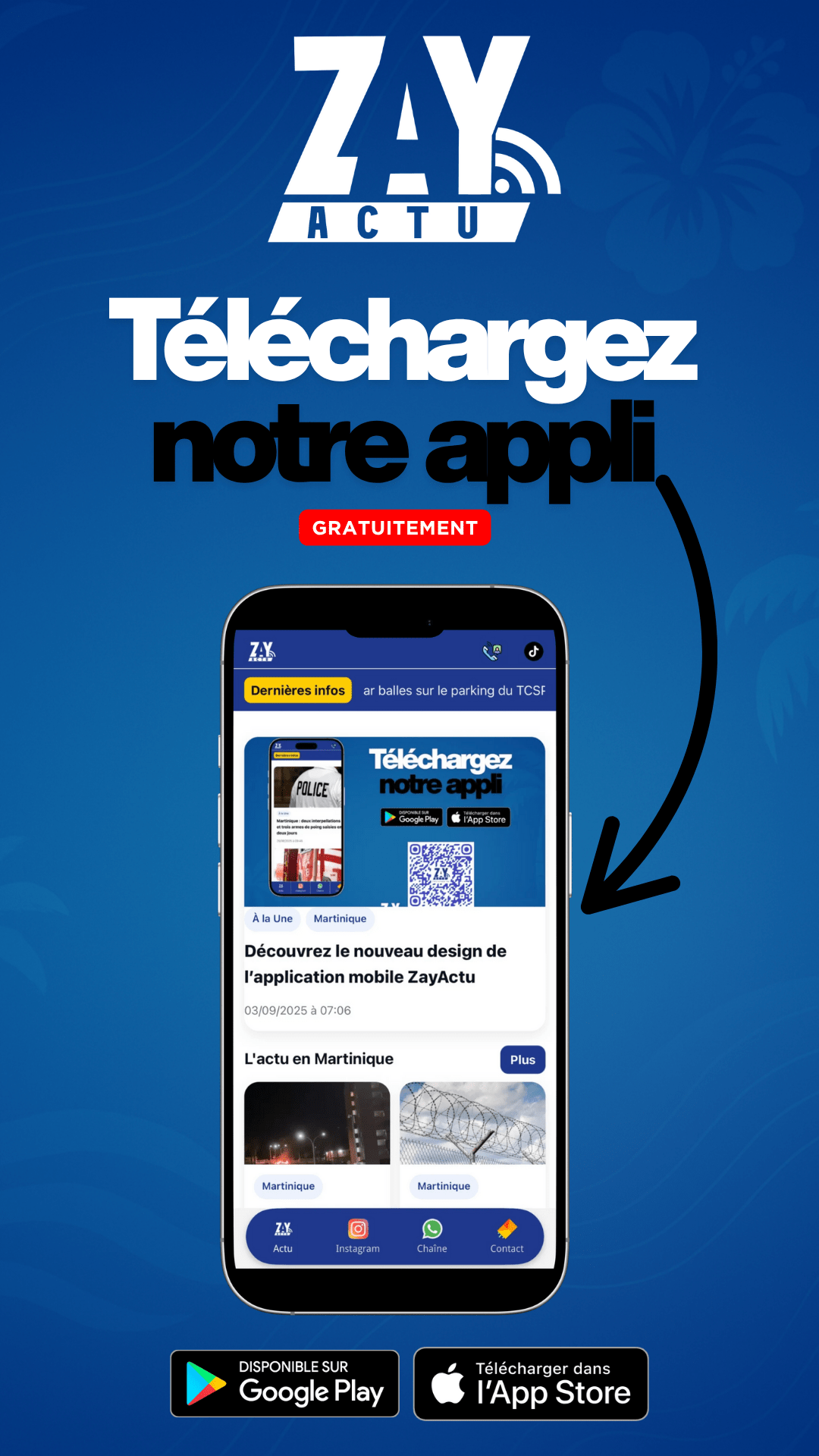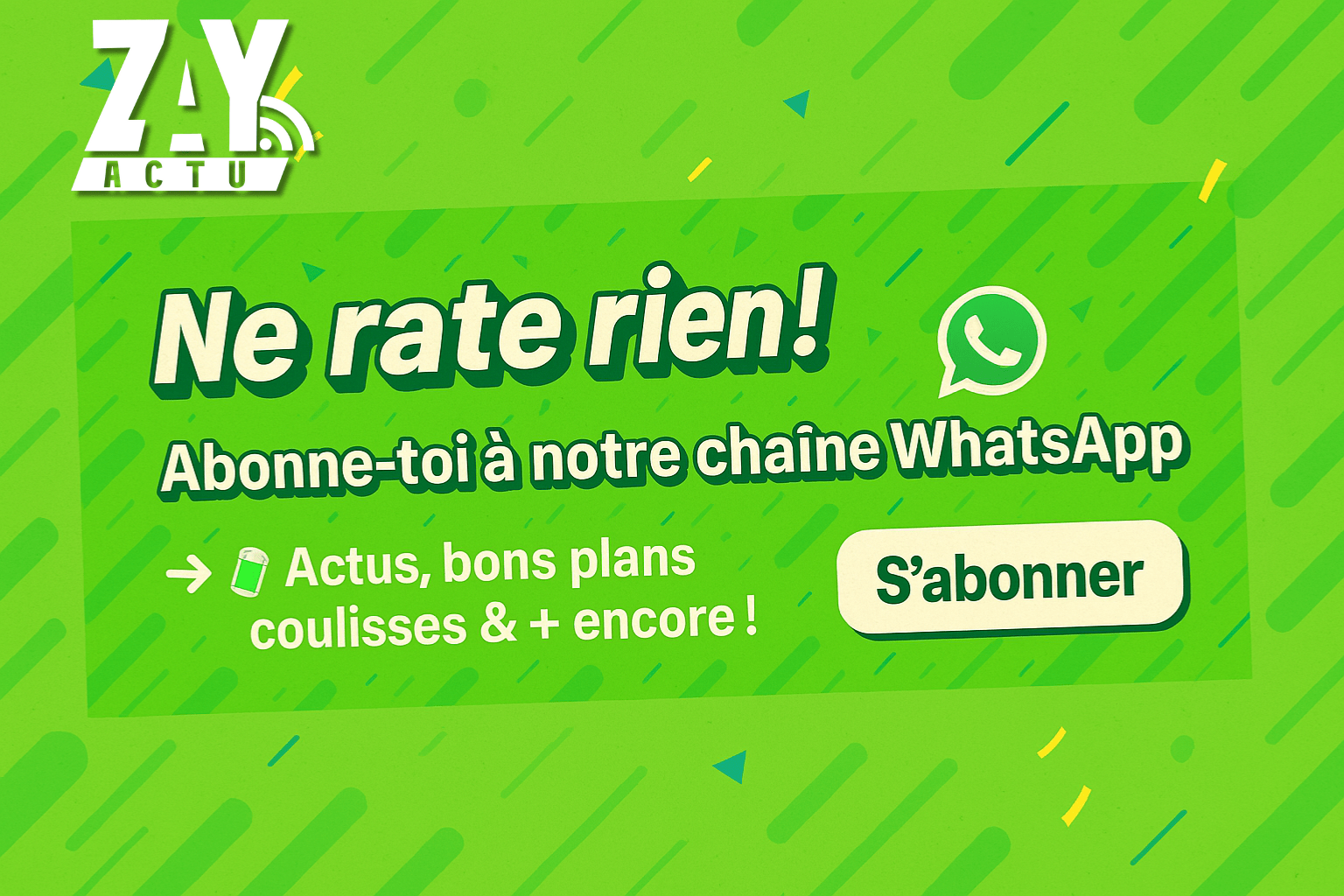- Désormais, le viol et les agressions sexuelles seront définis autour d’un principe clair : tout acte sexuel non consenti constitue une infraction pénale. Le consentement est reconnu comme libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Le silence ou l’absence de réaction ne pourront plus être interprétés comme un accord. Une avancée majeure vers une justice plus juste et une société plus respectueuse.
C’est une date symbolique pour les droits des femmes et la justice française. Après plusieurs mois de débats et d’allers-retours entre les deux chambres, le Sénat a adopté à l’unanimité, ce mercredi, la proposition de loi intégrant la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles.
Porté par les députées Marie-Charlotte Garin (Écologiste) et Véronique Riotton (Renaissance), ce texte vient combler un vide juridique souvent pointé du doigt. Dans les prochains jours, une fois la promulgation effectuée par le président de la République, la loi disposera clairement que « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti ».
Le consentement sera désormais défini comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Le texte précise qu’il « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » et rappelle qu’il n’existe pas de consentement lorsque l’acte est commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Vers une « culture du consentement »
La France rejoint ainsi les pays ayant déjà franchi ce cap, comme la Suède, le Canada, l’Espagne ou plus récemment la Norvège. Pour la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, cette réforme marque un changement profond de paradigme :
« Nous vivons depuis des siècles dans la culture du viol. Commençons à construire la culture du consentement. Quand vous ne dites pas oui, c’est non. Quand vous dites oui par peur, c’est non. Le seul oui qui vaille est un oui libre. »
Un long combat législatif
Cette évolution législative est le fruit d’un travail de fond entamé il y a près d’un an. Longtemps freinée par des inquiétudes juridiques et des divergences d’interprétation — y compris au sein de certaines associations féministes —, la réforme a finalement obtenu un large consensus.
Les craintes initiales portaient notamment sur une possible inversion de la charge de la preuve, qui aurait conduit les victimes à devoir démontrer leur absence de consentement, ou encore sur le risque d’une « contractualisation » des rapports sexuels. Ces inquiétudes ont été apaisées par l’avis du Conseil d’État rendu en mars dernier, confirmant la solidité juridique du texte.

Une avancée unanimement saluée
L’adoption de cette loi est saluée comme une victoire historique pour les droits des femmes et une reconnaissance pleine et entière de la notion de consentement dans le droit français. Une réforme qui, au-delà du cadre juridique, ambitionne de transformer en profondeur les mentalités et de poser les fondations d’une société fondée sur le respect et l’égalité.